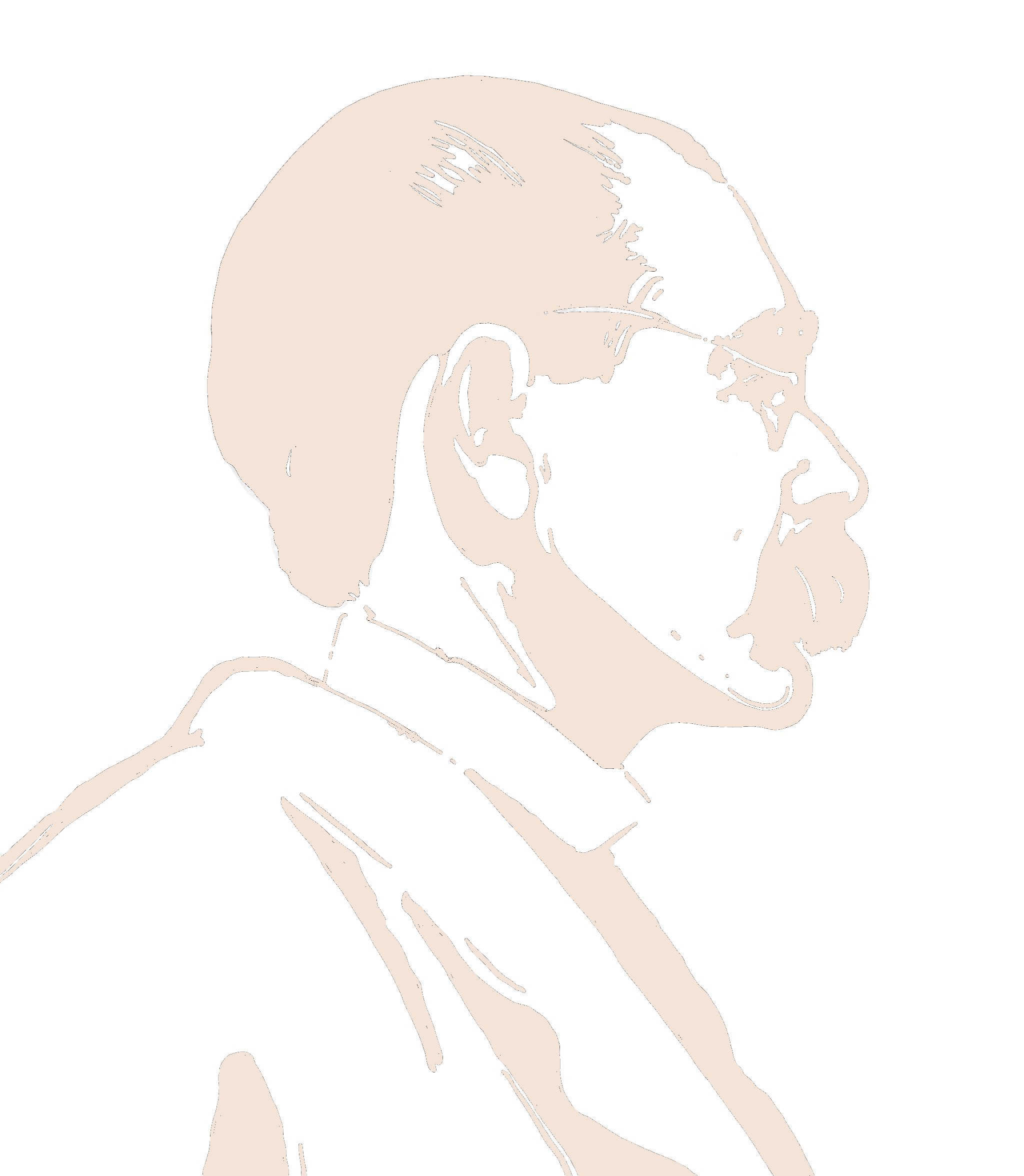Le Paris maçonnique, ballade symbolique et historique
Notes du Frère Gérard Gefen pour une visite-conférence réalisée en 2004
1) Palais Royal (source : Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris )
1771-1793 : Le duc de Chartres habite le palais parisien de la famille Orléans, le Palais Royal
![]()
C'est pendant l'époque où le duc de Chartres fut le propriétaire du Palais-Royal que ce palais subit sa plus importante transformation. Fortement endetté pour avoir mené une vie brillante, Philippe d'Orléans, afin de subvenir à ses besoins d'argent, fit construire, de 1781 à 1784, sur trois des côtés de l'immense jardin, cet ensemble monumental, ouvre de l'architecte Louis, auteur du théâtre de Bordeaux, que l'on voit de nos jours. D'un modèle uniforme, ces 60 pavillons à loyer, chacun de trois arcades en principe, comportaient un rez-dechaussée avec entresol, un étage de fenêtres décorées d'attributs, un attique, puis un dernier étage bordé d'une balustrade en pierre ornée de pots ; l'ensemble était enrichi de hauts pilastres composites cannelés, d'ordre colossal.
Les rez-de-chaussée constituaient une suite de galeries sur lesquelles ouvraient des boutiques communiquant avec le jardin par 180 arcades en plein cintre. Ces galeries étaient publiques, on pouvait y circuler de bout en bout jusqu'à 2 heures du matin, chaque arcade étant éclairée par un réverbère.
![]()
Le revers de cet ensemble donnait sur trois rues nouvelles, appelées, du nom des fils du duc d'Orléans, rues de Valois, de Beaujolais et de Montpensier ; elles étaient prises aussi sur le jardin initial dont la largeur se trouva ainsi bien diminuée.
Cette transformation du jardin souleva de véhémentes protestations de la part des propriétaires des maisons des rues des Bons-Enfants, des Petits-Champs et de Richelieu qui, au lieu d'avoir comme avant une vue directe sur le jardin, en eurent une sur le revers de cet ensemble érigé à 8 mètres en avant de leurs immeubles. Le duc d'Orléans passa outre et mit en vente les constructions nouvelles sur la base de 50 000 livres l'arcade (c'est-à-dire la boutique et les étages qui la surmontaient), en spécifiant que les acheteurs seraient astreints à les entretenir dans leur aspect d'origine et à ne jamais enlaidir leur décor par des enseignes ou autres marques tapageuses. On se moqua à Versailles de cette spéculation . « Mon cousin, vous allez donc tenir boutique et sans doute on ne vous verra plus que le dimanche, » dit ironiquement Louis XVI au duc d'Orléans.
En même temps, l'architecte Louis achevait les travaux commencés par Contant d'Ivry pour le remaniement des bâtiments du palais. II construisit le pavillon ouest de la cour d'honneur qui n'avait pas encore été édifié et il commença le théâtre destiné à remplacer la salle de l'Opéra brûlée le 8 juin 1781, après une représentation d'Orphée, de Gluck ( cf. r. Saint-Honoré) ; ce théâtre devait devenir notre Théâtre-Français ( cf . pl. du Théâtre-Français).
L'installation de commerçants dans les boutiques des galeries allait donner une extrême animation et une vie étincelante au jardin. De plus, comme le projet de fermer le côté nord de la cour d'honneur par un quatrième bâtiment destiné à remplacer l'ancienne galerie d'arcades à jour supportant une terrasse à balcon n'avait pu être réalisé faute d'argent et que, seules, les fondations de cette aile avaient été mises en place, on surmonta celles-ci, en 1784, de baraquements provisoires formant les fameuses galeries de bois. C'était un ensemble comportant, sous verrières, deux promenoirs entre trois rangées de boutiques. Ce lieu, connu au début sous le nom de Camp des Tartares, devint le foyer de toute l'animation du jardin. Il était assez mal famé et on disait, en 1786, qu'en plus des vieillards vicieux et des jeunes débauchés, il était « le lieu de rendez-vous de tous les crocs, escrocs, filous, mauvais sujets dont abondait la capitale ». Il y avait des attractions : Mlle Lapierre, une géante prussienne de 19 ans, haute de 2,20 m ; la belle Zulina, odalisque nue et étendue, statue de grandeur humaine en cire, mais recouverte d'une peau faisant illusion ; l'énorme Paul Butterlbrodt pesant 238 kilos ; une baraque où l'on montrait, pour deux sous, « ce que Dieu lui-même ne saurait jamais voir ». Le badaud qui y pénétrait s'y voyait dans un miroir, tandis qu'une voix caverneuse venue du comble disait : « Tu vois ton semblable, ce que ne saurait voir Dieu, car Dieu n'a pas de semblable. » Sous l'Empire, il y eut dans le sous-sol deux caveaux contenant chacun un petit théâtre dont la scène ne pouvait contenir que quatre ou cinq acteurs ; ceux-ci gagnaient 38 sous par jour, une bouteille de bière et un verre d'eau-de-vie.
Après la suppression, le 19 juin 1790, des titres de noblesse, le duc d'Orléans prit, le 15 septembre 1792, le nom de Philippe Egalité et le Palais-Royal, celui de Palais-Egalité. En octobre 1793, on confisqua le palais qui devint la propriété de l'Etat un mois avant la mort du duc d'Orléans, décapité. Une proposition de Lakanal tendant, en 1795, à la démolition du cidevant Palais-Royal n'ayant pas eu de suite, le palais fut attribué au Tribunat, l'une des deux assemblées fixées par la constitution de l'an VIII ; il y tint ses séances de 1801 à 1807. Pour l'installer, il avait fallu déloger - et ce ne fut pas sans peine - tous les parasites qui avaient pris possession des bâtiments. On aménagea une salle pour 250 députés dans le pavillon ouest de la cour d'honneur construit par l'architecte Louis. Après la dissolution du Tribunat 19 août 1807), Napoléon pensa un instant relier le Palais-Royal aux palais du Louvre et des Tuileries par une suite de portiques et d'arcades. Ce projet fut abandonné et, en définitive, ce furent le Tribunal de commerce et la Bourse, alors installée à l'église Notre-Dame des Victoires que l'on venait de rendre au culte, qui prirent, en 1809, la place du Tribunat. Cette habitation fut occupée, pendant les Cent-Jours, par Lucien Bonaparte.
à la Restauration, Louis XVIII restitua, le 18 mai 1814, à son cousin, le sixième duc d'Orléans, Louis-Philippe, fils aîné de Philippe Egalité, le palais de ses ancêtres que l'architecte Fontaine fut chargé de remettre en état, ce dont il avait grand besoin. Ce travail demanda dix-huit ans ; il entraîna la mise en place, par Gérard, en 1830, des quatre statues, la Science, le Commerce, l'Agriculture, la Navigation qui font pendant à celles de Pajou et la disparition, en 1826, des célèbres galeries de bois infestées de milliers de rats. En 1827, l'ex-salle du Tribunat fut remplacée par les grands appartements, l'aile de Valois fut achevée et celle de Montpensier fut construite. Ces deux ailes bordaient la cour d'honneur ; deux pavillons neufs, Valois et Montpensier, communiquant par une terrasse, recouvrant la galerie d'Orléans, les terminaient. La cour d'honneur fut entourée, sur trois de ses côtés, d'une colonnade assez sévère.
Le jardin subit sa première transformation en octobre 1730 ; les vieux marronniers et les vieux ormes centenaires furent abattus, sauf le long de la rue de Richelieu, et les deux bassins remplacés par un seul, édifié au centre, de 30 mètres de diamètre, avec jet d'eau. Il était séparé du palais par des parterres de gazon entourés d'ormes taillés en boule et de la rue des Petits-Champs par des quinconces de tilleuls agrémentés de bancs. Toujours ouvert au public, on y voyait, en 1752, dans la grande allée, une baraque de libraire fort bien achalandée, des demoiselles de petite vertu très recherchées et, dans l'allée plantée d'ormes parallèle à la rue de Richelieu, un arbre, dit l'arbre de Cracovie, où se rassemblaient les nouvellistes,, les oisifs et les flâneurs. Cet arbre était appelé ainsi parce qu'on n'y entendait, paraît-il, que des craques :
Chacun a son avis dont il ne fait nul doute,
Tous parlent à la fois et personne n'écoute ;
Et quand, à la dispute, on s'est bien échauffé
On finit tout débat en prenant du café.
Les Nouvellistes , comédie (1741).
Cette allée devait disparaître lors des constructions de Louis, en 1781. De l'autre côté se trouvait l'allée d'Argenson, ainsi nommée parce qu'elle était située en face de l'hôtel construit pour le comte d'Argenson (10 r. des Bons-Enfants). En son milieu était un banc sur lequel Diderot aimait s'asseoir pour rêver : « Qu'il fasse beau, qu'il fasse laid, c'est mon habitude d'aller vers les cinq heures du soir me promener au Palais-Royal; c'est moi qu'on voit toujours seul, rêvant sur le banc d'Argenson. » Cette allée disparut comme l'autre en 1781.
La construction, de 1781 à 1784, des rues de Montpensier, de Beaujolais et de Valois et des bâtiments qui les longèrent réduisit le jardin, qui n'eut plus environ que 275 mètres de long sur 100 de large, au lieu de 333 sur 143. Par contre, il allait connaître toute une vie nouvelle et devenir un centre d'animation et d'action bien plus intenses que ne l'avaient été auparavant la place Royale, le pont Neuf et la galerie Mercière du palais de Justice. Interdit aux soldats, aux gens en livrée, aux femmes en tablier, on le fermait le soir à 11 heures l'hiver, à 1 heure du matin l'été. C'était toujours dans la grande allée que, souvent par couples, les femmes s'exhibaient ; aussi est-ce là que, le 22 novembre 1787, le lieutenant Bonaparte fit sa première conquête.
Dans le but de remplacer le théâtre de l'Opéra installé ailleurs depuis l'incendie du 8 juin 1781 ( cf . r. Saint-Honoré), le duc d'Orléans fit construire, en 1786, au milieu du jardin (emplacement du bassin actuel et de la plus grande partie des deux carrés de gazon) une salle immense creusée à 5 mètres en terre et élevée de 3 au-dessus du sol, qui fut appelée le cirque ; on accédait à ses parties basses par des galeries souterraines. La salle terminée, on ne sut quel usage en faire, l'autorité ayant interdit d'y présenter des spectacles. On y donna donc quelques fêtes, repas, jeux, bals, tableaux vivants, puis, à partir du 14 avril 1791, un peu de théâtre, ainsi que des conférences littéraires et scientifiques (le Lycée des Arts) ; l'abbé Fauché, « procureur général de la Vérité », y prêcha la Révolution avec le zèle d'un apôtre. Finalement, le cirque brûla, le 16 décembre 1798, avec la ménagerie qui y était établie ; un orang-outang fut calciné.
L'idée du duc d'Orléans de doter le Palais Royal d'un théâtre qui en fût digne réussit mieux lorsqu'il fit construire, à l'angle sud-ouest du palais, une salle provisoire, le théâtre des Variétés du Palais Royal, remplacée, le 15 mai 1790, par une construction définitive, notre Théâtre-Français ( cf . Pl. du Théâtre-Français).
Le duc d'Orléans avait toujours interdit à la police d'entrer chez lui, aussi le jardin du Palais Royal jouissait-il d'une liberté que l'on ne trouvait nulle part ailleurs dans Paris. Celle-ci est à la base des scènes qui s'y déroulèrent dès le début de la Révolution née, en quelque sorte, dans ce jardin, le 13 juillet 1789, lorsque Camille Desmoulins, monté sur une table devant le café de Foy, appela la foule aux armes : « Citoyens, le renvoi de Necker est le tocsin d'une Saint-Barthélemy des patriotes. Ce soir même tous les bataillons suisses et allemands sortiront du Champ-de-Mars pour nous égorger; il ne nous reste qu'une ressource, c'est de courir aux armes. » Il fallait un signe de ralliement ; le vert, couleur d'espérance, fut choisi ; des feuilles arrachées aux arbres servirent de cocardes. Le 22 juillet suivant, la tête de Foulon (74 ans), administrateur de l'armée chargée de marcher sur Paris et à qui on prêtait le propos : « Si cette canaille n'a pas de pain, qu'elle mange du foin », fut promenée dans le jardin au bout d'une pique avec du foin dans la bouche ; le 16 avril 1791, le mannequin du pape, pris dans le musée de cire de Curtius, fut brûlé en signe de protestation, le pape ayant défendu ses droits sur Avignon et le comtat Venaissin. Peu après, le ci-devant marquis de Saint-Huruge, passé dans le camp des révolutionnaires, s'y fit botter le bas du dos par des « monarchiens » qui lui reprochaient sa trahison ; il resta placide devant ces coups, répondant à ceux qui blâmaient sa lâcheté
« Je ne m'occupe jamais de ce qui se passe derrière moi. » En 1792, Lafayette fut, à son tour, brûlé en effigie dans le jardin ; la même année, en juillet, le député Duval d'Espréménil, jadis si populaire, fut arrêté sur la terrasse des Feuillants, traîné au Palais Royal et précipité dans le bassin où il faillit se noyer. Le 29 janvier 1793, le député Le Pelletier de Saint-Fargeau, qui venait de voter la mort de Louis XVI, fut assassiné, en fin de soirée, par l'ancien garde du corps Pâris, dans le sous-sol d'un café de la galerie de Valois. Le Pelletier de Saint-Fargeau eut des funérailles triomphales, il fut même inhumé au Panthéon ; quant à Pâris, on ne le rattrapa jamais. Enfin, le duc d'Orléans fut arrêté dans son palais, le 7 avril 1793, avec le duc de Beaujolais, le plus jeune de ses fils, âgé de 13 ans, le seul qui soit resté au palais, et incarcéré au fort Saint-Jean, à Marseille, où sa femme, la douce Marie-Adélaïde de Bourbon-Penthièvre, sa sueur, la duchesse de Bourbon, et le duc de Montpensier le rejoignirent. Il y résida quelques mois avant d'être ramené à Parts pour comparaître devant le Tribunal révolutionnaire où il se défendit avec adresse et sang-froid. Il fut décapité le 6 novembre 1793, à 4 heures de l'après-midi ; la charrette qui le conduisait de la Conciergerie à l'échafaud ayant été arrêtée un instant à la suite d'un embouteillage devant son palais, Philippe Egalité fut hué par la foule ; il eut pour elle un geste de mépris et dit : « Ils m'applaudissaient autrefois. » C'est avec beaucoup de courage qu'il affronta la guillotine.
Aux jacobins et aux « tricoteuses» succéda la réaction thermidorienne avec ses merveilleuses vêtues d'une gaze assez transparentes et ses muscadins porteurs de cannes plombées ; ces derniers devinrent les maîtres des cafés, de celui de Foy en particulier. L'agiotage apparut avec le Directoire ; les meneurs des nombreuses maisons de jeu (18 en 1804) entraînèrent dans leur sillage nombre de filles galantes qui pullulèrent aux portes des tripots et des cafés. Les premiers étaient fort courus; on conte qu'il arriva souvent à Fouché de glisser quelques rouleaux de pièces d'or dans la main de Joséphine de Beauharnais. Cependant, les galeries du Palais-Royal et même les galeries de bois abritèrent parfois une société plus choisie, des savants libraires comme Dentu, des cabinets littéraires estimés et des restaurateurs comme Chevet, qui allaient devenir célèbres dans toute l'Europe.
Le lendemain de Waterloo vit, de 1815 à 1817, l'envahissement du jardin par les Alliés, les Prussiens, les ultras et les demi-solde. Les premiers y laissèrent des fortunes, tel Blücher qui perdit un soir 1 500 000 francs au jeu, ce qui fit dire que les Alliés abandonnèrent dans ces tripots et dans le sac des filles une somme supérieure aux indemnités que la France avait à leur payer.
Le jardin commença à prendre sa physionomie actuelle à la fin du règne de Charles X lorsque le préfet de police, Debelleyme, fit disparaître, en 1829, les enseignes et autres verrues qui déshonoraient les belles façades de ses arcades. De son côté, LouisPhilippe s'employa à débarrasser le jardin de la cinquantaine de tripots et des nombreuses prostituées établis sous ses fenêtres ; c'est ainsi qu'en 1828 les galeries de bois disparurent.
C'est à leur place que s'élève, de nos jours, la galerie d'Orléans que construisit Fontaine de 1829 à 1831 ( cf . cette voie).
Après la fermeture, le 31 décembre 1836, des maisons de jeu et l'expulsion de la clientèle qui gravitait autour d'elles, le jardin du Palais-Royal devint le désert qu'il n'a cessé d'être quels qu'aient été les efforts faits à diverses époques pour essayer de le ranimer ; même Robert Houdin et ses automates n'arrivèrent pas à secouer la torpeur dont il est resté frappé. II est maintenant guetté par ceux qui, lui faisant grief de constituer un bouchon dans les voies de la circulation parisienne, verraient avec plaisir son éventrement, le prolongement de la rue Vivienne jusqu'à la place du Palais Royal et celui de la rue Driant jusqu'à l'avenue de l'Opéra.
A remarquer le petit canon-chronomètre qu'un sieur Rousseau avait installé, en 1786, sur la ligne du méridien de Paris ; il tonnait à midi précis, les jours de soleil, de mai à octobre
En ce jardin tout se rencontre,
Hormis de l'ombrage et des fleurs;
Si l'on y dérègle ses moeurs,
Au moins on y règle sa montre .
a dit l'abbé Delille. Transporté par le propriétaire du café du Caveau à la croisée de l'étage où étaient ses salons afin d'attirer la clientèle (les jours où il n'y avait pas de soleil, un consommateur était autorisé à allumer l'amorce avec son cigare), il fut replacé, sous le Directoire, vers 1799, sur la borne de granit qu'il occupe encore aujourd'hui et où il a continué à tonner jusqu'en 1914.
1738-1741 : L'intendant de Paris René Hérault habite l'hôtel sis 46 à 50 rue des Petits Champs
Question : Quel était le Vénérable séduit par la Carton fin 1737 : Le Noir de Cintré ou Paris de la Montagne ?
Appartint au duc d'Orléans de 1782 à 1788 ! Démoli en 1827.
2°) Saint-Germain
dès 1726
( ???) Saint Thomas - chez le traiteur Huré, rue des Boucheries Saint-Germain (partie ouest de la rue de l'École de Médecine et en partie absorbée par le boulevard Saint-Germain ; les numéros 146 à 166 de ce dernier en faisaient partie).
1729 ? Existence non certaine)
Les Arts Sainte-Marguerite ou à la Ville de Tonnerre, rue des Boucheries Saint-Germain.
1732 (dès 1729 ?)
Saint Thomas au Louis d'Argent : chez le traiteur Nicolas-Alexis Landelle, hôtel de Bussy ( 4 rue de Buci )
![]()
Loge de Bussi-Aumont - chez le traiteur Nicolas-Alexis Landelle, hôtel de Bussy ( 4 rue de Buci ), puis hôtel d'Aumont (7 rue de Jouy).
Emplacement d'un hôtel ayant appartenu, en 1582, au conseiller, notaire et secrétaire du roi, Bénigne Le Ragois. Son fils, Claude, qui devait faire construite le fastueux hôtel de Bretonvilhers de l'île Saint-Louis, y naquit en 1582, ainsi que, en 1621, le fils de ce dernier, Alexandre Le Ragois de Bretonvilliers, futur curé de Saint-Sulpice (1652) et directeur du séminaire de Saint-Sulpice (1658). Claude Le Ragois quitta, pour son hôtel de l'île Saint-Louis, cette demeure qui appartint, en 1676, à sa fille, Marie Le Ragois. Celle-ci épousa le président à mortier Louis-Dominique de Bailleul de Soisy qui mourut en 1701. L'hôtel resta dans la famille de Bailleul jusqu'en 1737, année où il passa dans celle des Portail de Vaudreuil. Le traiteur Landelle loua, au début du xviii e siècle, un bâtiment situé au fond de la cour, dit hôtel de Bussy, où il servit des dîners dont le prix variait de 3 à 24 livres par tête.
Si la première loge maçonnique de Paris fondée, en 1725, par trois Anglais, se tint, en 1732, au premier étage de ce restaurant - c'était la Loge de Bussy -, la maison de Landelle fut surtout celle des poètes et chansonniers qui, de 1733 à 1742, tinrent leur dîner de quinzaine dans une salle basse du rez-de-chaussée, privée de fenêtres, qu'on surnomma le Caveau, d'où le nom donné à cette compagnie.
C'était une société gastronomique et littéraire, fondée en 1729 par Piron,
![]()
Collé et Gallet, célèbre par les chansons joyeuses qui accompagnaient les repas. On y rencontrait des chansonniers, des grands seigneurs, des beaux esprits et des littérateurs connus le poète tragique Crébillon ; son fils, le romancier qui, étant censeur royal, donna le célèbre imprimatur : « J'ai lu, par ordre de Mgr le Chancelier, l'ouvrage intitulé le Coran , par le sieur Mahomet, et n'y ai rien trouvé de contraire à la religion ni aux bonnes moeurs ; signé : Crébillon fils » ; l'auteur Piron, dont Louis XV n'approuva pas l'élection, en 1753, à l'Académie française à cause d'une ode licencieuse qu'il avait écrite quarante-quatre ans auparavant, lorsqu'il avait 20 ans ; le littérateur et philosophe Helvétius, fermier général à 23 ans, dépensant les 300000 francs que lui rapportait sa charge en libéralités envers les gens de lettres qu'il traitait magnifiquement (un de ses livres, De l'esprit , fut brûlé par le bourreau) ; le musicien Rameau, qui composait les airs de chant et de danse pour les opëras-comiques que Piron faisait représenter à la foire Saint. Germain ; le poète Gresset, novice que les jésuites venaient de chasser ; le peintre Boucher, dont Mme de Pompadour grava elle-même certains tableaux ; le poète-chansonnier Collé, qui, destiné à la chicane, préféra la chanson et fonda le Caveau avec Piron et le chansonnier Gallet ; celui-ci fit faillite comme épicier en gros et se réfugia dans l'asile de l'enclos du Temple où il conserva sa gaieté malgré sa misère et son hydropisie ; le chansonnier Panard, le chanteur Jelyotte...
Plusieurs sociétés de même nature succédèrent, sous le même nom, au premier Caveau. Le second siégea dans un sous-sol du Palais-Royal (ce fut l'époque de Marmontel, du littérateur Suard) ; le troisième, constitué sous l'Empire et animé par Désaugiers, s'installa au Rocher de Cancale de la rue Montorgueil.
Cet hôtel, acheté, en 1750, par Landelle à la veuve du premier président Antoine Portail de Vaudreuil, appartint après sa mort survenue ici, en 1769, à ses huit enfants qui le vendirent, en 1792, à la veuve d'un directeur de verrerie. Il appartint, en 1811, à Devicque qui reconstruisit, en 1828, le bâtiment en façade sur la rue ; de 1829 à 1876, à son gendre, l'avoué Le Couturier et à ses descendants ; de 1876 à 1901, à Lefort et, en 1901, au négociant Hellers qui reconstruisit ce même bâtiment en 1903 alors qu'était démoli celui du Caveau.
après 1732 (1734)
Loge du duc de Richmond :Hôtel de Keroualle (ou de Gouffier de Thoix),
![]()
56 rue de Varenne (se réunit aussi à Aubigny sur Cère).
Construit pour Henriette de Penacoët de Kéroualle, marquise de Gouffier de Thoix, soeur cadette de Louise, duchesse de Portsmouth, maîtresse de Charles II. Richmond, cousin de Derwentwater, en descend. Il est aussi duc d'Aubigny sur Nère
Les 18-20 septembre 1734, loge avec Désaguliers et Montesquieu. Mais ici ou hôtel de Bussy ?
1735
Lord Derwentwater - décapité en 1746 (son frère en 1716) -
habite l'Hôtel Impérial, 16 rue Dauphine (hôtel meublé).
![]()
1736
Loge Coustos-Villeroy (en faire l'historique) rue des Boucheries Saint-Germain puis Hôtel de Bourgogne (20 rue Étienne Marcel).
[aujourd'hui c'est une école primaire à cet endroit]
1745-1755
Lacorne donne des leçons de danse à l'académie des du Gard, 10/12 rue de l'Université .
N° 10 . - Maison ayant appartenu au peintre et graveur à l'eau forte Samuel Bernard (1615-1687), élève de Vouet. Son fils, Samuel, le futur célèbre financier,
![]()
y naquit, le 28 novembre 1651. Samuel Bernard père quitta cet hôtel, vers 1685, pour le no 12 désigné ci-après. Sa veuve la loua, en 1696, au comte d'Egmont, son fils, Samuel Bernard, le financier (1651-1739), en 1710, au marquis d'Hallot que remplaça, en 1711, l'intendant d'Alsace, Félix Le Pelletier de la Houssaye (1663-1723). Elle devint, vers 1730, la propriété du second des fils du financier, Gabriel-Bernard de Rieux (1687-1745), président au parlement qui la fit réparer, en 1736, par Desrochers et la loua à l'abbé Franquini, envoyé du grand-duc de Toscane, puis, en 1743, à la veuve du comte de Valence. Son fils, Bernard-Henri de Boulainvilliers (1724-1798), président au parlement et prévôt de Paris, la loua, en 1749, à Louis d'Aumont, duc d'Humières.
L'historien Amédée Thierry (1797-1873), frère d'Augustin Thierry, l'habita de 1842 à 1849.
N° 12 , - Seconde maison ayant appartenu au peintre Samuel Bernard désigné ci-dessus qui la loua, en 1666, au marquis de Saint-Luc d'Epinay. Samuel Bernard vint l'habiter en 1685 et y mourut en 1687, à 72 ans ; sa veuve continua à l'habiter jusque vers 1690. Elle fut louée, vers 1702, à l'écuyer Bonaventure du Gard, dont l'académie de manège était située rue de Verneuil, dos à dos avec le n° 10 mentionné ci-dessus et avec laquelle elle communiquait. II l'occupa avec ses élèves internes et y fut remplacé, en 1733, par son fils aîné, Jean-Léon du Gard et, après la mort de celui-ci, en 1737, par son fils cadet, Jacques Philippe du Gard. Cette maison que Desrochers avait également restaurée en 1737 fut louée, en 1755, par Bernard-Henri de Boulainvilliers nommé ci-dessus, à Renard de Rouffiac, receveur des finances à Limoges.
1774
Installation du Grand Orient rue du Pot de fer
![]()
(actuellement 82 rue Bonaparte )
Le Grand-Orient prend à bail pour un loyer annuel de 5 400 livres l'ancien noviciat des jésuites, rue du Pot-de-Fer au faubourg Saint-Germain. Luxembourg chargea le frère Poncet, architecte, d'aménager l'ancienne jésuitière en temple maçonnique. On y trouvait au premier étage trois salles abritant les ateliers communiquant par des portiques en enfilade. Dans la longue salle du fond, que l'on distinguait dès l'entrée entre les colonnes, s'élevait le trône du Grand-Maître sur un piédestal de sept degrés sous un dais d'or et d'argent, flanqué par les deux fauteuils de l'administrateur général et du Grand-Conservateur. Mercier, dans son Tableau de Paris , s'exclame sur la vicissitude des choses humaines en voyant les Maçons successeurs des jésuites : Quand je suis sous ces voûtes inaccessibles aux grossiers rayons du soleil, ceint de l'auguste tablier, je crois voir errer toutes ces ombres jésuitiques qui me lancent des regards furieux et désespérés. Et là j'ai vu entrer frère Voltaire, au son des instruments dans la même salle où on l'avait maudit tant de fois théologiquement.
Hors visite
(Dénominations des rues et numéros actuels)
7 place Vendôme
LE CLUB DE L'ENTRESOL (1720-1731) - Fondé par l'abbé Pierre-Joseph Alary, en 1720, le Club de l'Entresol fut une compagnie privée qui réunit une vingtaine de participants au 7, Place Vendôme, dans l'entresol (d'où son nom) du logement du président Hénault (amant de Madame du Deffand, ne pas confondre avec le préfet Hérault). On y rencontrait des esprits sérieux et hardis qui s'intéressaient aux questions politiques. La conférence avait lieu tous les samedis, de cinq heures du soir à huit heures.
Dans le groupe des habitues notons : René Louis de Voyer, marquis d'Argenson, futur ministre aux Affaires étrangères de France; Charles de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu; le marquis de Balleroy, Charles Irénée Castel, abbé de Saint-Pierre qui y exposa son projet de paix perpétuelle; les abbés de Bragelonne et de Pomponne, Madame du Deffand, Madame de Luxembourg, Madame de Pont de Veyle, Madame de Rochefort, Madame d'Ussé, Madame de Forqualquier, le chevalier de Ramsay et plusieurs gentilshommes comme François de Franquetot, duc de Coigny, maréchal de France; Matignon, Lassay, Noirmoutiers, et Saint-Contest.
Inquiété par les succès des Lumières, Louis XV mit fin à toutes ces cogitations politiques en fermant l'endroit en 1731, au moyen d'un Grand Acte royal.
Il ne faut pas confondre cet endroit avec l'hôtel Hénault de Cantobre situé au numéro 82 de la rue François Miron construit pour Hénault de Cantobre, fermier général. Celui-ci, père du président Hénault (Chambre des enquêtes) donna des dîners célèbres dans cette résidence qui fut plus tard habitée par le fils.
![]()
1725 -1728
Le chevalier RAMSAY habite chez le duc de Sully, hôtel de Sully (65 rue Saint-Antoine) puis en 1736 chez le prince de Turenne (66 rue de Turenne)
![]()
1736-1743
Le duc d' Antin habite l'hôtel de ce nom
(2, rue Louis le Grand, 33 boulevard des Italiens et 34 rue Saint Augustin)
1737
Assemblée des freys-massons , chez Chapelot, La Rapée (actuel Parc de Bercy)
1744
Descente de police chez le traiteur Ozouf, foire Saint-Laurent (rue Saint-Laurent)
Descente de police à la Loge Luxembourg, rue de l'Ourcine (rue Broca, sans doute au ou vers le numéro 25)
1745
Descente de police à l'hôtel de Soissons (sur l'emplacement de l'actuelle Bourse du Commerce, rue Coquillière)
Descente de police chez le sieur Pique (rue des Martyrs, alors extra muros)
1746
Loges Écossaises rue Saint-Paul, rue des Deux Boules et rue Poissonnière
1750 (vers)
Pény père, V.·. M.·. de la Loge Saint-Martin , habite près de l'église Saint-Leu-Saint Gilles, 92 rue Saint-Denis
![]()
1753-1771
Le duc de CLERMONT habite l'hôtel (démoli en 1847) sis à l'emplacement de l'actuel 136 boulevard Voltaire.
![]()
1774-1798
Savalette de Langes habite son hôtel, 350 rue Saint-Honoré
1773
La Grande Loge Nationale se tient (sans doute vers le 27) rue Saint-Antoine. Le duc de Luxembourg habite son hôtel à côté, 26 rue Geoffroy L'Asnier.
Première réunion du Grand Orient de France , à la Folie-Titon, 31 rue de Montreuil.
![]()
Conférence du F. Gerard Gefen de 2004